
Du côté de l’opéra français
"Patrie !", Duos d’opéras français du XIXème siècle : F. Halévy, C. Saint-Saëns, J. Massenet, Ch. Gounod, É. Paladilhe, A. Thomas. Hjördis Thébault (soprano), Pierre-Yves Pruvot (baryton), Orchestre Philharmonique de Kosice, dir. Didier Talpain. Brilliant Classics 94321.
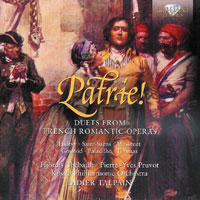 Hjördis Thébault et Pierre-Yves Pruvot mettent depuis longtemps un point d’honneur à explorer des ouvrages méconnus, et à revivifier des courants historiques dont la compréhension éclaire les pans de répertoire ayant franchi la barre de la postérité. Ils nous proposent aujourd’hui un panorama des différents genres pratiqués sur les scènes françaises au long du XIXème siècle, puisque leur sélection s’étend de 1843 à 1891. De longues scènes (4 sur 7 dépassent les 10 minutes) permettent de vibrer à l’expression dramaturgique sans être frustrés par la fragmentation qu’induit généralement le principe du récital. On s’en réjouit d’autant plus que les deux chanteurs font preuve d’un véritable engagement d’acteurs dans leurs incarnations de personnages si différents. De surcroît, ils s’attachent à la défense du chant français, avec tout ce que cela comporte quant à la projection du galbe vocal et de la déclamation, et – par les temps qui courent ! – on est tout surpris de comprendre ce que les interprètes nous racontent (non !?... est-ce possible !?... ô miracle !).
Hjördis Thébault et Pierre-Yves Pruvot mettent depuis longtemps un point d’honneur à explorer des ouvrages méconnus, et à revivifier des courants historiques dont la compréhension éclaire les pans de répertoire ayant franchi la barre de la postérité. Ils nous proposent aujourd’hui un panorama des différents genres pratiqués sur les scènes françaises au long du XIXème siècle, puisque leur sélection s’étend de 1843 à 1891. De longues scènes (4 sur 7 dépassent les 10 minutes) permettent de vibrer à l’expression dramaturgique sans être frustrés par la fragmentation qu’induit généralement le principe du récital. On s’en réjouit d’autant plus que les deux chanteurs font preuve d’un véritable engagement d’acteurs dans leurs incarnations de personnages si différents. De surcroît, ils s’attachent à la défense du chant français, avec tout ce que cela comporte quant à la projection du galbe vocal et de la déclamation, et – par les temps qui courent ! – on est tout surpris de comprendre ce que les interprètes nous racontent (non !?... est-ce possible !?... ô miracle !).
È scherzo od è follia, s’interrogeait le héros verdien d’Un Ballo in Maschera : ainsi pourrait-on manifester sa perplexité devant le choix d’ouvrir ce programme conséquent par une scène – Charles VI de Fromental Halévy, duo Odette et le Roi – qui frise la caricature du formalisme et des éclats héroïques (l’orchestre marche au pas cadencé !) en vogue dans le "Grand Opéra" historique français. Mais cet extrait s’avère le plus ancien (1843) de la sélection et nous montre, avant de passer à de plus honorables pages, d’où venaient les auteurs lyriques nationaux (ils revenaient de loin, mamma mia !) ; on y décèle pourtant de très passagères préfigurations de Bizet. Le contraste ne valorise que mieux l’extrait d’Henry VIII de Saint-Saëns placé consécutivement – Acte I, sc.2 – : 40 années ont passé, et un souci de vérité dramatique a infusé les genres lyriques ; Saint-Saëns se croyait un auteur théâtral méritant (ce qu’il n’était pas, confronté à son grand rival en l’époque, Massenet), et seul Samson et Dalila a survécu au répertoire ; néanmoins, Henry VIII, rescapé du reste de sa production scénique, résisterait peut-être à l’épreuve des planches, et ce dialogue tendu entre Catherine d’Aragon (un fort beau rôle, ici admirablement défendu) et Henry déploie de longues sinuosités qui laissent s’épanouir la psychologie des personnages.
Massenet, justement, interviendra deux fois dans ce programme : le premier extrait provient d’un oratorio (mais l’expression sacrée de Massenet n’est-elle pas empreinte d’une sensualité toute lyrique ?) – il s’agit du splendide duo d’amour entre Adam et Ève – mais il représente le seul moment où l’on conteste l’interprétation, car le chef attaque la longue introduction dans un tempo excessivement lent qui bride l’élan amoureux, le geste suggestif des enivrantes (et fort peu chastes) courbes, et par là-même, gomme tout ce que l’on peut y lire de préfiguration de Manon et autres productions théâtrales à venir (Massenet composa Ève en 1874) ; d’autre part, les chanteurs ne sont point là dans leur tessiture idéale (aigus trop sollicités). Combien de fois faudra-t-il répéter que Massenet se montrait fort exigeant sur le respect de tempi dictant une vie dramatique non alanguie ?! On a transformé sa musique en guimauve, ce qui a nui à sa réception et généré une avalanche de clichés préjudiciables, alors que son expression affirme un ton beaucoup plus viril qu’on ne le croit généralement chez ce chantre de la femme (les deux concepts ne sont pas antagonistes : ils seraient même plutôt complémentaires, ne croyez-vous pas ?!).
Y succède la grâce mélodique plus conventionnelle de Gounod (Polyeucte, 1878 : duo Pauline/Sévère de l’Acte II, avec une cabalette qui porte le conventionnel à son comble). Mais le meilleur est à venir : tout d’abord une scène brève mais violente, au ressort dramatique ravageur, extraite d’un ouvrage qui fut extrêmement célèbre jusqu’au début du XXème siècle, Patrie! d’Émile Paladilhe (1886) ; le livret sortait de l’imagination de Victorien Sardou (l’on reconnaît les noires intrigues de l’auteur de Fedora et de La Tosca) et de la plume mélique de Louis Gallet (librettiste, pour Massenet, des oratorios Marie-Magdeleine puis Ève, et des opéras Le Roi de Lahore, Le Cid, Thaïs) ; la musique mériterait probablement une résurrection, et le relief dramatique du duo final de l’Acte II/1er tableau (d’où l’influence verdienne n’est pas absente) se voit porté à l’incandescence par les trois interprètes (chanteurs et chef). Suit, en guise d’intermède pour détendre les auditeurs, une page au délicieux orientalisme parodique qui révéle un aspect ignoré d’Ambroise Thomas, la veine comique : Le Caïd (1849) ; Hjördis Thébault et Pierre-Yves Pruvot y roucoulent avec malice. Ils ne roucoulent plus du tout, mais donnent de toutes leurs tripes une impressionnante vigueur théâtrale au dernier – et le plus vaste – extrait qui constitue le sommet du disque : Le Mage de Massenet (Introduction, air et duo Varedha/Amrou, Acte II sc.1) ; créé en 1891 à l’Opéra de Paris, ce magistral ouvrage demeure inexplicablement dans l’ombre ; il est pourtant pleinement représentatif de la puissante inspiration tragique du compositeur (sur un livret d’un célèbre littérateur : Jean Richepin), soutenue par une somptueuse orchestration d’un grand relief. Didier Talpain anime cette fois les riches textures d’une sève vivifiante, drapant les amples contours de l’air de Varedha dessinés avec une noble émotion par Hjördis Thébault. Dans la déchirante douleur de le jeune femme, son père, le grand prêtre Amrou, vient instiller le poison de la vengeance, et le rôle nous montre Pierre-Yves Pruvot sous le versant d’une inquiétante autorité.
Peut-on imaginer que ce disque, tout nouveau, constitue le seul moyen actuel d’accéder auditivement – et, par bonheur, de fort belle manière – à un fragment de la partition du Mage ?! Alors que l’on dépense tant d’argent à exhumer des colifichets musicaux sortis des besogneuses industries de petits maîtres, un chef-d’œuvre d’un de nos plus grands auteurs lyriques reste celé aux oreilles des mélomanes ! Rien que pour cette scène, le présent disque restera indispensable.
La notice de Didier Talpain brosse un panorama de l’histoire des scènes et genres lyriques parisiens qui aidera utilement l’acquéreur à se repérer. Car ce disque doit impérativement être acquis pour parfaire sa culture en matière d’opéra.
Jules MASSENET : Werther. Rolando Villazón (Werther), Sophie Koch (Charlotte), Audun Iversen (Albert), Eri Nakamura (Sophie), Alain Vernhes (le Bailli), Orchestre du Royal Opera Covent Garden, dir. Antonio Pappano. DGG 477 9340 (2 CDs).
 On connaissait la belle mise en scène de Benoît Jacquot grâce à un fameux DVD Decca dirigé à l’Opéra de Paris par Michel Plasson avec Jonas Kaufmann. Dans le cadre d’une co-production, c’est en fait la même mise en scène qui fut représentée à Covent Garden en Mai 2011, et la captation audio retraverse la Manche sous la baguette "maison". Il arrive que les tempi de Michel Plasson (que l’on peut aussi entendre diriger la version baryton avec Thomas Hampson lors d’un concert au Châtelet : un DVD Virgin) nous chatouillent par un penchant excessif à privilégier l’ampleur sonore en réfrénant le dynamisme du discours, mais ce petit travers devient bénin, comparé au pathos insupportablement alangui d’Antonio Pappano.
On connaissait la belle mise en scène de Benoît Jacquot grâce à un fameux DVD Decca dirigé à l’Opéra de Paris par Michel Plasson avec Jonas Kaufmann. Dans le cadre d’une co-production, c’est en fait la même mise en scène qui fut représentée à Covent Garden en Mai 2011, et la captation audio retraverse la Manche sous la baguette "maison". Il arrive que les tempi de Michel Plasson (que l’on peut aussi entendre diriger la version baryton avec Thomas Hampson lors d’un concert au Châtelet : un DVD Virgin) nous chatouillent par un penchant excessif à privilégier l’ampleur sonore en réfrénant le dynamisme du discours, mais ce petit travers devient bénin, comparé au pathos insupportablement alangui d’Antonio Pappano.
Les anciens "péchés" (pas mignons du tout !) de Pappano – dont on l’on avait cru guéri, à entendre ses récentes réalisations – réapparaissent à traits épais. De surcroît, on s’étonne – et on souffre – du jeu médiocre des solistes issus des pupitres de cordes : de nombreux DVD (chez Opus Arte, notamment) nous ont permis de suivre l’orchestre de Covent Garden sans être gênés comme ici par un manque d’homogénéité ou par des imperfections de jeu ! La prise de son en "live", un peu cotonneuse et manquant de définition, n’arrange rien, à l’évidence, puisqu’on ne peut compter sur elle pour dessiner les arêtes et reliefs qui font cruellement défaut à la direction de Pappano, mais on ne saurait tout lui imputer ! Alain Vernhes campe très justement le Bailli, entouré de comparses donnant toute satisfaction. Sophie Koch –une bonne Charlotte, même si elle ne marque pas le rôle de manière immortelle – sacrifie parfois à la facilité de changer la sonorité des syllabes qui la dérangent. Quant à Villazón, on ne saurait nier la richesse de son timbre mais, voyez-vous, l’un des attraits méritoires de la version pour baryton du rôle de Werther réside précisément dans le fait que les barytons nous épargnent... les effets de ténor (sanglots, attaques artificielles de la glotte, théâtralité factice, etc.) ! Au fait, une élémentaire question : avait-on vraiment besoin d’une millième version de Werther, alors que certains ouvrages – et non des moindres ! – de Massenet ne sont plus disponibles dans le commerce (ou ne l’ont jamais été : lire ci-dessus) ?
Francis POULENC : Dialogues des Carmélites. Sally Matthews (Blanche de la Force), Hendrickje van Kerckhove (Sœur Constance), Deborah Polaski (la première Prieure, Mme de Croissy), Heidi Brunner (la deuxième Prieure, Madame Lidoine), Michelle Breedt (Mère Marie de l’Incarnation), Jean-Philippe Lafont (Marquis de la Force), Yann Beuron (Chevalier de la Force), Jürgen Sacher (l’Aumônier). Arnold Schönberg Chor, ORF Radio-Symphonieorchester Wien, dir. Bertrand de Billy. Oehms OC 931.
 Bizarre montage – provoqué par d’involontaires perturbations – que celui-ci, entre une production de 2008 (mise en scène par Robert Carsen) et sa reprise en 2011, toutes deux captées par l’ORF ! Une telle distance, qui nuit à l’homogénéité du vécu dramatique, est-elle cause de la carence que nous ressentons, relativement à l’élan dont on attendrait qu’il soulevât l’ensemble des tableaux ? La direction de Bertrand de Billy – un chef pourtant convaincant, lors de maints spectacles – peine à porter le lyrisme des motifs que le compositeur a su découper avec une vigoureuse concision ; l’émotion en pâtit, et même la scène finale – qui tirerait les larmes à des pierres – manque d’envolée dans la grandeur et ne produit pas l’effet d’ascension spirituelle escompté.
Bizarre montage – provoqué par d’involontaires perturbations – que celui-ci, entre une production de 2008 (mise en scène par Robert Carsen) et sa reprise en 2011, toutes deux captées par l’ORF ! Une telle distance, qui nuit à l’homogénéité du vécu dramatique, est-elle cause de la carence que nous ressentons, relativement à l’élan dont on attendrait qu’il soulevât l’ensemble des tableaux ? La direction de Bertrand de Billy – un chef pourtant convaincant, lors de maints spectacles – peine à porter le lyrisme des motifs que le compositeur a su découper avec une vigoureuse concision ; l’émotion en pâtit, et même la scène finale – qui tirerait les larmes à des pierres – manque d’envolée dans la grandeur et ne produit pas l’effet d’ascension spirituelle escompté.
Les psychologies admirablement tracées par Bernanos et Poulenc ne trouvent pas leur juste relief en raison d’erreurs de distribution. Au sein d’un plateau aussi uniment féminin (les rôles masculins ne sont que des comparses), rien n’importe plus que de distinguer chaque caractère par la couleur vocale correspondant à l’âge et au tempérament du personnage. Que cette caractérisation connaisse une faille, et tout l’équilibre de la distribution se trouve compromis. Blanche de la Force souffre ici d’une émission désagréablement cuivrée (et avec un médium qui "tube") ; ainsi, lors du premier dialogue au parloir, la voix trop clairement sopranisante de Deborah Polaski (dont on aurait pu supposer que son âge la colore de mûre affirmation) et celle trop corsée de Sally Matthews se croisent en une gênante inversion d’autorité. Madame Lidoine et Mère Marie de l’Incarnation manquent, l’une de rondeur, l’autre d’ascendant... tout simplement parce qu’elles ont des moyens insuffisants pour vaincre les redoutables courbes et les aigus encore plus redoutablement projetés que Poulenc leur a destinés ! Les francophones interprètes du Marquis et du Chevalier de la Force tirent avec aisance leur épingle du jeu.
La platitude de la notice du livret (en fait, du programme de salle) est indigne d’un opéra magnifiant l’un des plus puissants textes qui soient, celui de Bernanos !
Pour mémoire, rappelons la distribution inégalée de l’enregistrement publié en 1964 par La Voix de son maître, sous la direction de Pierre Dervaux : Denise Duval (Blanche de la Force), Denise Scharley (Mme de Croissy), Régine Crespin (Mme Lidoine), Rita Gorr (Mère Marie), Liliane Berton (Sœur Constance), Xavier Depraz (le Marquis de la Force). A-t-on jamais recréé une alliance aussi accomplie de caractérisation dramatique et de modelé vocal ?...
En serpentant sur les routes d’Europe
Frederick DELIUS : The complete Delius Songbook, vol.1. Mark Stone (baryton), Stephen Barlow (piano). Stone records 5060192780062 (distr. Codaex).
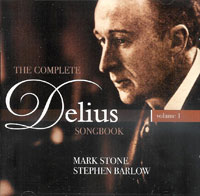 La musique de Delius, compositeur anglais mais d’origine allemande et de vie très cosmopolite (Scandinavie, Allemagne, U.S.A., France), séduit par une teinte nostalgique très sensible et de délicates saveurs harmoniques (non exemptes d’influence debussyste, parfois). On connaît mal ses mélodies : louons le baryton Mark Stone d’en entreprendre une édition intégrale, accompagnée de livrets bien documentés (en anglais). Dans ce premier volume, on croise quelques illustres poètes britanniques (dont Shakespeare, et Percy Bysshe Shelley qui éveille un puissant lyrisme) mais une importante livraison de mélodies d’inspiration norvégienne retient notre attention : Delius s’était lié d’amitié avec Grieg, et avec le poète Bjørnstjerne Bjørnson qu’il mit en musique. Il pratiquait la langue norvégienne ; il semble pourtant probable qu’il travailla sur les traductions allemandes de ces vers qu’il connut par les mélodies de Grieg et d’Halfdan Kjerulf. Mark Stone a choisi de les chanter en anglais (doit-on le regretter pour des raisons d’adéquation de la ligne vocale ? Le livret fournit toutefois les poèmes en norvégien), les adaptations dans sa langue ayant été éditées et retravaillées – pour nombre d’entre elles – par Peter Pears (une adaptation supplémentaire due à Mark Stone vient s’y ajouter). Un commun esprit contemplatif, mélancolique, unit Delius à ces expressions nordiques, et se communique à l’auditeur, d’autant que le timbre généreux de Mark Stone se fait enveloppant, secondé par la vigilante collaboration du pianiste Stephen Barlow. La prise de son très présente étaye l’impact de cet enregistrement qui nous révèle d’émouvantes pages.
Le 150ème anniversaire de la naissance du compositeur donne lieu à diverses parutions, et l’on saluera la réédition en coffret économique (8 disques : Decca 478 3078) d’une large anthologie de pages orchestrales et lyriques (pour l’essentiel dirigées par Sir Charles Mackerras), concertantes et chambristes, qui ne laisse dans l’ombre aucun des versants représentatifs de l’art du compositeur.
La musique de Delius, compositeur anglais mais d’origine allemande et de vie très cosmopolite (Scandinavie, Allemagne, U.S.A., France), séduit par une teinte nostalgique très sensible et de délicates saveurs harmoniques (non exemptes d’influence debussyste, parfois). On connaît mal ses mélodies : louons le baryton Mark Stone d’en entreprendre une édition intégrale, accompagnée de livrets bien documentés (en anglais). Dans ce premier volume, on croise quelques illustres poètes britanniques (dont Shakespeare, et Percy Bysshe Shelley qui éveille un puissant lyrisme) mais une importante livraison de mélodies d’inspiration norvégienne retient notre attention : Delius s’était lié d’amitié avec Grieg, et avec le poète Bjørnstjerne Bjørnson qu’il mit en musique. Il pratiquait la langue norvégienne ; il semble pourtant probable qu’il travailla sur les traductions allemandes de ces vers qu’il connut par les mélodies de Grieg et d’Halfdan Kjerulf. Mark Stone a choisi de les chanter en anglais (doit-on le regretter pour des raisons d’adéquation de la ligne vocale ? Le livret fournit toutefois les poèmes en norvégien), les adaptations dans sa langue ayant été éditées et retravaillées – pour nombre d’entre elles – par Peter Pears (une adaptation supplémentaire due à Mark Stone vient s’y ajouter). Un commun esprit contemplatif, mélancolique, unit Delius à ces expressions nordiques, et se communique à l’auditeur, d’autant que le timbre généreux de Mark Stone se fait enveloppant, secondé par la vigilante collaboration du pianiste Stephen Barlow. La prise de son très présente étaye l’impact de cet enregistrement qui nous révèle d’émouvantes pages.
Le 150ème anniversaire de la naissance du compositeur donne lieu à diverses parutions, et l’on saluera la réédition en coffret économique (8 disques : Decca 478 3078) d’une large anthologie de pages orchestrales et lyriques (pour l’essentiel dirigées par Sir Charles Mackerras), concertantes et chambristes, qui ne laisse dans l’ombre aucun des versants représentatifs de l’art du compositeur.
Artur SCHNABEL : Quatuor à cordes n°1 ; Notturno op.16 (*). Pellegrini Quartett ; Noa Frankel (contralto) et Irmela Roelcke (piano) (*). CPO 777 622-2.
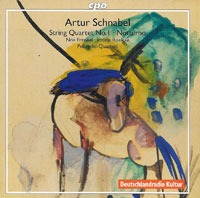 Tout le monde connaît le grand pianiste Artur Schnabel (1882-1951), infatigable apôtre (et même, pour des pans entiers de leur corpus de Sonates, re-découvreur) de Beethoven et de Schubert en un temps où cela n’était guère si fréquent. Mais la diffusion de son œuvre de compositeur s’avère beaucoup plus confidentielle. Et pourtant... Parmi les nombreux compositeurs-interprètes dont la célébrité de concertiste occulta l’activité créatrice, il est l’un des plus personnels et des plus avancés, peu suspect de post-romantisme attardé comme d’autres de ses confrères. Quelques disques (on en trouvera la liste sur le site de la Fondation Schnabel :
http://www.schnabelmusicfoundation.com/as_compositions.htm), dont seules les références Chandos et CPO sont aisément disponibles, nous permettent de goûter une palette harmonique très dense, une écriture atonale ayant retenu certains aspects de Schönberg.
Tout le monde connaît le grand pianiste Artur Schnabel (1882-1951), infatigable apôtre (et même, pour des pans entiers de leur corpus de Sonates, re-découvreur) de Beethoven et de Schubert en un temps où cela n’était guère si fréquent. Mais la diffusion de son œuvre de compositeur s’avère beaucoup plus confidentielle. Et pourtant... Parmi les nombreux compositeurs-interprètes dont la célébrité de concertiste occulta l’activité créatrice, il est l’un des plus personnels et des plus avancés, peu suspect de post-romantisme attardé comme d’autres de ses confrères. Quelques disques (on en trouvera la liste sur le site de la Fondation Schnabel :
http://www.schnabelmusicfoundation.com/as_compositions.htm), dont seules les références Chandos et CPO sont aisément disponibles, nous permettent de goûter une palette harmonique très dense, une écriture atonale ayant retenu certains aspects de Schönberg.
Le Quatuor Pellegrini entreprend une intégrale des quatuors à cordes de Schnabel... ce qui n’est pas vraiment engageant ! Le jeu plutôt rêche, voire râpeux quand les difficultés d’exécution se font trop sentir, des instrumentistes accuse l’aridité des contrepoints schoenbergiens sans rendre justice aux versants plus personnels du style de Schnabel, lorsque des vents tourbillonnants emportent l’écriture touffue. Les formes, immenses et insolites, que bâtit Schnabel exigent souplesse et agilité – autant d’esprit que de technique – pour sillonner les juxtapositions de caractères qu’il parsème de surprises syntaxiques.
On pense à la célèbre phrase de Schoenberg : « Ma musique n’est pas moderne, elle est seulement mal jouée ». De fait, la prompte évolution ces dernières années de l’interprétation schoenbergienne, de par une normale assimilation de son langage au fil des générations successives, lui a donné raison. Mais, trop rarement abordée, la musique de Schnabel n’a pas encore atteint ce ton d’évidence qui permettrait à la richesse expressive de se dégager si des interprètes de haut vol se l’appropriaient plus fréquemment. La même problématique resurgit à propos de la pièce vocale du programme.
Le Notturno du ténébreux poète Richard Dehmel inspira La Nuit transfigurée à Schoenberg et fut mis en musique par Richard Strauss, mais l’imposant poème musical (plus de 20 minutes) que composa en 1914 Artur Schnabel et qu’il joua en 1918 avec sa femme, la cantatrice Therese Behr, se distingue comme un diamant noir dans la production de l’époque. Les deux interprètes du présent disque semblent avancer sur la pointe des pieds dans cette nuit qu’elles ne transfigurent pas. Ainsi abordé, ce chef-d’œuvre semble étriqué, longuet, ce qui dessert sa construction dramatique difficile à maîtriser. Si vous voulez écouter un récit frémissant de vie, reportez-vous à l’interprétation de Dietrich Fischer-Dieskau et Aribert Reimann qui venaient d’exhumer la partition l’année précédant ce récital à la Radio de Berlin (6 février 1985) où ils réunissaient divers lieder sur des poèmes de Dehmel (Strauss, Pfitzner, Zemlinsky, Webern, Reger, Szymanowski, Ansorge ; un disque publié en 1995 par le label Orfeo, C 390 051 B). Certes, la transposition de la partie vocale au baryton (qui descend même vers un grave à la limite des possibilités de Fischer-Dieskau) change son intrication dans le tissu harmonique de la partie pianistique qui va de la plus extrême délicatesse à une écriture fouillée et à des flambées réveillant des références au répertoire de clavier, mais cette épineuse partition ne s’accomode pas d’interprètes tâtonnants.
Tomás MARCO : 22 Tarots, Presto mormorando, Sonata de fuego. Marcello Fantoni (guitare). Dynamic CDS 708.
 Tomás Marco (né en 1942) fut l’un des acteurs les plus engagés de l’avant-garde espagnole (il suivit les cours de Darmstadt au temps de Boulez, Maderna, Stockhausen), tout en sachant préserver les traits de son identité espagnole. On ne s’étonnera donc pas que la guitare ou le clavecin l’aient régulièrement attiré. Les œuvres ici regroupées appartiennent à une période plus récente (1990 à 1996) et quelle n’est pas notre déception de constater que Marco, jadis si personnel, abandonne progressivement ses audaces pour verser dans le néo-tonalisme ! Il n’en demeure pas moins un homme habile à mettre en valeur la guitare, à la faire sonner au gré d’une palette richement évocatrice, et l’on se prend à regretter qu’il brise lui-même l’homogénéité de ses meilleures trouvailles en se laissant aller à des affadissements de son langage. Ainsi de la Sonata de fuego, vaste composition en quatre mouvements (27 minutes) : appâtés par un tel titre et par le début du premier mouvement, on se dit (on espère !) qu’un poème nourri des plus inextinguibles mythes hispaniques va jaillir. Que viennent alors y faire de plates petites ritournelles néo-classiques ?! L’intérêt faiblit, se trouve sans cesse délayé par des digressions qui ne tiennent pas les promesses nées de motifs fortement typés, et la longueur devient problématique.
Tomás Marco (né en 1942) fut l’un des acteurs les plus engagés de l’avant-garde espagnole (il suivit les cours de Darmstadt au temps de Boulez, Maderna, Stockhausen), tout en sachant préserver les traits de son identité espagnole. On ne s’étonnera donc pas que la guitare ou le clavecin l’aient régulièrement attiré. Les œuvres ici regroupées appartiennent à une période plus récente (1990 à 1996) et quelle n’est pas notre déception de constater que Marco, jadis si personnel, abandonne progressivement ses audaces pour verser dans le néo-tonalisme ! Il n’en demeure pas moins un homme habile à mettre en valeur la guitare, à la faire sonner au gré d’une palette richement évocatrice, et l’on se prend à regretter qu’il brise lui-même l’homogénéité de ses meilleures trouvailles en se laissant aller à des affadissements de son langage. Ainsi de la Sonata de fuego, vaste composition en quatre mouvements (27 minutes) : appâtés par un tel titre et par le début du premier mouvement, on se dit (on espère !) qu’un poème nourri des plus inextinguibles mythes hispaniques va jaillir. Que viennent alors y faire de plates petites ritournelles néo-classiques ?! L’intérêt faiblit, se trouve sans cesse délayé par des digressions qui ne tiennent pas les promesses nées de motifs fortement typés, et la longueur devient problématique.
Trop long également l’ensemble de miniatures composant le cycle des 22 Tarots : on conseillerait volontiers aux interprètes de sélectionner une demi-douzaine de cartes parmi celles présentant une recherche de timbres, ou des jeux de résonance par l’utilisation contrastante des différents registres de l’instrument. Il y a loin de l’écriture conventionnelle de certaines des premières figures à l’originalité des peintures macabres : la percussion, le brouillard de vibrations, les pas mystérieux composent un tableau suggestif autour du Pendu, lequel précède La Mort à l’obsédant effet de glas recréé par les résonances métalliques d’une insolite disposition harmonique. On apprécie également le crépitement des dissonances du Diable, et les parallélismes pour ainsi dire post-debussystes du Fou que viennent briser des éclats de fureur hispanique.
Le Presto mormorando – pas si murmurant – est une pièce de virtuosité qui devrait tenter nombre de guitaristes. L’Italien Marcello Fantoni, un esprit ouvert et curieux de nouveaux répertoires, porte une louable attention aux recherches de couleurs et à l’éloquence de son jeu : on aimerait alors l’entendre dans des œuvres antérieures du même Tomás Marco.
Sylviane Falcinelli