
Jules Massenet : "Méditations". Nathalie Manfrino (soprano), Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, dir. Michel Plasson. Decca 476 4823.
 ... Ou comment une fausse bonne idée retourne en vieille lune un projet né dans l’enthousiasme. "Méditations", dit le titre qui recouvre une sélection d’airs couvrant tout le champ chronologique de la carrière lyrique de Massenet, ainsi que des airs d’oratorios et un détour par les "tubes" mélodiques. Oui, mais à se complaire dans le ton méditatif, on atteint la plage 12 (celle précédant l’entrée en scène de Manon, qui ne saurait être taxée de personnage méditatif !) sans jamais avoir décollé d’une atmosphère confite en langueurs exquises. Au point que l’auteur de ces lignes avoue s’être ennuyée au bout d’une heure, et il en faut beaucoup pour ennuyer une oreille aussi acquise à Massenet ! C’est que ça dégouline de su-sucre, au fil de ces interprétations apportant de l’eau au moulin des détracteurs du compositeur, toujours prompts à fustiger un prétendu sentimentalisme sirupeux sans jamais avoir été vérifier si la culpabilité n’en revenait pas à certaines "traditions" d’interprétation ! Massenet est bien plus viril, que diantre ! Et d’abord, pour assurer à ce programme la diversité d’inspiration qui est une qualité maitresse de notre compositeur, encore eût-il fallu que la caractérisation des différents rôles s’accompagnât d’un changement de couleur vocale selon les personnages : or, Nathalie Manfrino ne sait pas pratiquer ce travail dramatique, et la monotonie s’installe. Grisélidis ressemble à Sapho, elles ressemblent à la Vierge, et ainsi de suite. Moduler "Pleurez mes yeux" en jouant la carte du langoureux tient du contresens : Chimène traverse les coups du sort, animée d’un constant état d’esprit de colère, et on doit sentir ce tempérament de feu dans la caractérisation vocale. L’adieu à la vie d’Ariane se parait d’une expressivité bien plus variée dans l’interprétation de Rosamund Illing dirigée par Richard Bonynge (qui accompagnera Nathalie Manfrino au Théâtre des Champs-Élysées le 31 mars prochain), sans compter que le disque australien (label Melba) produisait la scène intégrale, avec l’appel des sirènes. Et que dire de l’air par lequel Cléopâtre invite avec un sadisme inouï ses esclaves à boire une coupe empoisonnée en échange d’un baiser ! Nathalie Manfrino le chante dans un tempo alangui, sans que rien, dans sa gentille sensualité, ne laisse percer la perversité assassine d’une souveraine autocrate.
... Ou comment une fausse bonne idée retourne en vieille lune un projet né dans l’enthousiasme. "Méditations", dit le titre qui recouvre une sélection d’airs couvrant tout le champ chronologique de la carrière lyrique de Massenet, ainsi que des airs d’oratorios et un détour par les "tubes" mélodiques. Oui, mais à se complaire dans le ton méditatif, on atteint la plage 12 (celle précédant l’entrée en scène de Manon, qui ne saurait être taxée de personnage méditatif !) sans jamais avoir décollé d’une atmosphère confite en langueurs exquises. Au point que l’auteur de ces lignes avoue s’être ennuyée au bout d’une heure, et il en faut beaucoup pour ennuyer une oreille aussi acquise à Massenet ! C’est que ça dégouline de su-sucre, au fil de ces interprétations apportant de l’eau au moulin des détracteurs du compositeur, toujours prompts à fustiger un prétendu sentimentalisme sirupeux sans jamais avoir été vérifier si la culpabilité n’en revenait pas à certaines "traditions" d’interprétation ! Massenet est bien plus viril, que diantre ! Et d’abord, pour assurer à ce programme la diversité d’inspiration qui est une qualité maitresse de notre compositeur, encore eût-il fallu que la caractérisation des différents rôles s’accompagnât d’un changement de couleur vocale selon les personnages : or, Nathalie Manfrino ne sait pas pratiquer ce travail dramatique, et la monotonie s’installe. Grisélidis ressemble à Sapho, elles ressemblent à la Vierge, et ainsi de suite. Moduler "Pleurez mes yeux" en jouant la carte du langoureux tient du contresens : Chimène traverse les coups du sort, animée d’un constant état d’esprit de colère, et on doit sentir ce tempérament de feu dans la caractérisation vocale. L’adieu à la vie d’Ariane se parait d’une expressivité bien plus variée dans l’interprétation de Rosamund Illing dirigée par Richard Bonynge (qui accompagnera Nathalie Manfrino au Théâtre des Champs-Élysées le 31 mars prochain), sans compter que le disque australien (label Melba) produisait la scène intégrale, avec l’appel des sirènes. Et que dire de l’air par lequel Cléopâtre invite avec un sadisme inouï ses esclaves à boire une coupe empoisonnée en échange d’un baiser ! Nathalie Manfrino le chante dans un tempo alangui, sans que rien, dans sa gentille sensualité, ne laisse percer la perversité assassine d’une souveraine autocrate.
Au fait, à lire ce qui précède, vous aurez compris qu’une même voix enchaîne Manon, Ariane, Chimène, Cléopâtre, etc. : cherchez l’erreur ! Pour rappel des classifications, Manon est un « soprano lyrique léger », Ariane et Grisélidis appartiennent au rang des « sopranos dramatiques », Chimène se situe à la lisière du soprano dramatique et du mezzo-soprano, et Cléopâtre devrait être (!) un contralto. Le rôle de Cléopâtre – comme tant d’autres œuvres de la dernière décennie de la vie de Massenet – avait été composé pour Lucy Arbell, mais à la mort de Massenet, un complot familial visa à déposséder l’inspiratrice du compositeur des créations posthumes que celui-ci lui garantissait par testament (la contralto intenta – et gagna d’ailleurs – une action en justice à ce sujet), et la création de Cléopâtre échut à la soprano Marie Kouznetzov qui avait épousé Alfred Massenet (dont elle divorça plus tard), neveu de Jules. Pour ce faire, on procéda sur la partition à autant de transpositions et "dérangements" qu’il y a de jours dans l’année : autant dire un infâme charcutage ! En vertu de quoi, Montserrat Caballé a pu, depuis, chanter (!) Cléopâtre.
On ne saurait nier que Nathalie Manfrino soit animée d’un amour sincère de Massenet (même si elle parsème au passage ses propos d’approximations biographiques !). Mais a-t-elle les moyens de son amour ? La voix ne dispense ses qualités que sur un registre plutôt court : l’aigu s’avère prompt à se tendre et à trémuler ; lorsque, à la fin de « Charme des jours passés », Nathalie Manfrino redescend d’un aigu atteint dans la douleur en chantant le mot « pitié », c’est nous qui avons envie de nous exclamer : « Pitié ! ». Quant au grave, il sonne sourdement : l’Ave Maria sur la Méditation de Thaïs tombe à cet égard sans appel ; lors du concert de l’Atelier lyrique à l’Amphithéâtre Bastille, Andreea Soare l’avait mieux chanté, sans compter que la version (authentique) avec violoncelle (surtout jouée par Alexis Descharmes !) et piano offre une originalité plus séduisante. Nathalie Manfrino a dû beaucoup travailler pour réussir les deux airs d’Esclarmonde (un rôle qu’elle serait incapable de chanter à la scène), encore qu’il ne s’agisse pas des pages les plus pyrotechniques, mais pour camper la magicienne séductrice, une voix plus riche d’autorité s’impose (Joan Sutherland n’a pas encore été détrônée). Nous qualifierons de... bizarres ses maniérismes vocaux et sa déclamation dans le premier air de Manon. Nous en venons alors au problème si courant : la diction du français. Suivant une tendance fort répandue (hélas !), Madame n’hésite pas à changer la coloration élocutoire des syllabes qui la dérangent ; en vertu de quoi, on comprend une phrase sur trois, guère plus !
Appelé sur le tard en renfort du projet, armé de toute son expérience, Michel Plasson enrobe les orchestrations d’un son moelleux... que le traitement de l’enregistrement fait virer au molletonné : n’importe quel technicien du son identifiera (par exemple à l’écoute du début de l’Élégie ou dans l’air d’Ariane) l’ "arrangement" des réglages opéré en studio. À l’arrivée, un Massenet en doudoune ouatinée ! Emporté par son amour d’un lyrisme ample et chaleureux, Michel Plasson a toujours eu tendance à freiner les tempi dans Massenet, et, compte tenu des failles que nous venons de pointer dans le programme, ce petit travers accentue l’onctuosité affadissant l’ensemble du disque.
Le livret nous apprend (photos très "glamour" obligent !) que la chanteuse est habillée par Azzaro, de même qu’il importait de faire savoir que Balenciaga habille Hélène Grimaud : Universal ne lance plus des musicien(ne)s mais des top-models.
Exhumations diverses dans le "campo santo" de la musique française
Charles Gounod : Biondina ; mélodies italiennes ; 4 pièces pour piano. Francesco Paolo Tosti : Non t’amo più, Tormento, L’ultima canzone. David Lefort (ténor), Simon Zaoui (piano). Hortus 084 (distr. Codaex).
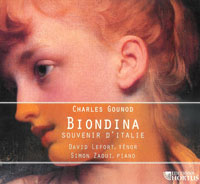 Dénonçons d’emblée une imposture : la page (anonyme) présentant les biographies des interprètes nous annonce « la partition méconnue de Biondina de Charles Gounod, qui est le premier vrai cycle de mélodies écrites par un compositeur français au XIXème siècle ». On s’étrangle en lisant ces lignes ! Biondina, nous explique Gérard Condé dans son propre texte (ses travaux antérieurs sur Massenet l’auraient préservé d’énoncer une telle ânerie, mais il aurait été bien inspiré d’effectuer le rappel historique que nous esquissons ici) a été composée de mars 1872 à janvier 1873 ; or à cette date, Massenet, cadet d’une génération par rapport à Gounod, avait déjà composé et publié deux cycles pour une voix et piano (Poème d’avril, 1866, Poème du Souvenir, 1868), plus un cycle pour chœur féminin et ténor solo (Poème pastoral, 1871)... et quels cycles, et quel contenu dramatique dans l’art de dessiner immédiatement une atmosphère ! En effet, l’audacieux jeune Massenet, méditant sur les prolégomènes schumanniens, affichait d’emblée les intuitions que ses préoccupations futures développeraient, en intégrant le piano comme interlocuteur de plein exercice, et en réclamant de la voix soliste le passage d’une déclamation parlée au chant. Rien d’audacieux en revanche dans le cycle italianisant composé postérieurement par l’aîné Gounod (1818-1893) : on entend une guirlande de romances et de canzonette assez fades, au banal accompagnement chitarresco, d’ailleurs peu susceptibles d’être portées par les vers d’un certain Giuseppe Zaffira, d’une effarante platitude dans la syntaxe italienne qui, par moments, semble la traduction de gallicismes ! Les autres mélodies italiennes de Gounod, composées durant son séjour à Londres, ne changent rien à ce point de vue. Que dire des quelques pièces pour piano seul... mamma mia !... quand on pense que les pages pianistiques de Massenet ont pu être qualifiées de "salonnardes" !... mais elles sont à côté de celles-ci ce que la Hammerklavier est à une page "galante" ! Aucune imagination harmonique, aucun devenir du discours dans la composition, rien que mièvrerie ! Il faut dire que les interprètes ne font rien pour sauver ces mignardises : ils les traitent comme il fut en usage de traiter la musique française, c’est-à-dire en ne dépassant pas le registre de la grâce futile et en prenant avec des pincettes ces bibelots fragiles qui, croit-on, risqueraient de se briser si on les empoignait plus vigoureusement. On sait les méfaits commis à une certaine époque envers Massenet ou Fauré (et tant d’autres) à les considérer ainsi ! Par ailleurs, on se moque sans cesse de la prononciation des artistes lyriques étrangers chantant la musique française ; je crois bien que les Italiens auraient matière à nous retourner la pareille en écoutant David Lefort, dont les moyens s’inscrivent dans le profil type de ces voix dépourvues de projection formées au chant baroque et limitées, pour le répertoire postérieur, à la mélodie. Le piège réside dans le complément de programme, puisé chez Tosti (pour le coup, Gérard Condé commet une approximation en décrivant le compositeur italien comme « contemporain de Gounod », alors qu’il est son cadet d’une bonne génération, et le presque exact contemporain de Massenet, avec un strict décalage de 4 ans : Massenet, 1842-1912, Tosti, 1846-1916). Dieu sait que Tosti ne saurait passer pour un génie frappé du sceau de l’originalité, mais par rapport à Gounod, ses pages exhalent au moins des saveurs proches des mélodies écrites par les compositeurs (sommairement, voire improprement) dits "véristes" ; quant aux poèmes qu’elles illustrent, ils se tiennent, du point de vue de la langue italienne, à un niveau "convenable" si on les compare à l’ineffable Zaffira. Il manque à David Lefort la solaire vocalità d’un Italien (sans parler de ce que cela révèle de ses limites : aïe, le vers « Nina, rammenta » !), et Simon Zaoui oublie que le phrasé et les dynamiques de son accompagnement pianistique auraient pu évoquer des élans clairement issus de l’opéra italien.
Dénonçons d’emblée une imposture : la page (anonyme) présentant les biographies des interprètes nous annonce « la partition méconnue de Biondina de Charles Gounod, qui est le premier vrai cycle de mélodies écrites par un compositeur français au XIXème siècle ». On s’étrangle en lisant ces lignes ! Biondina, nous explique Gérard Condé dans son propre texte (ses travaux antérieurs sur Massenet l’auraient préservé d’énoncer une telle ânerie, mais il aurait été bien inspiré d’effectuer le rappel historique que nous esquissons ici) a été composée de mars 1872 à janvier 1873 ; or à cette date, Massenet, cadet d’une génération par rapport à Gounod, avait déjà composé et publié deux cycles pour une voix et piano (Poème d’avril, 1866, Poème du Souvenir, 1868), plus un cycle pour chœur féminin et ténor solo (Poème pastoral, 1871)... et quels cycles, et quel contenu dramatique dans l’art de dessiner immédiatement une atmosphère ! En effet, l’audacieux jeune Massenet, méditant sur les prolégomènes schumanniens, affichait d’emblée les intuitions que ses préoccupations futures développeraient, en intégrant le piano comme interlocuteur de plein exercice, et en réclamant de la voix soliste le passage d’une déclamation parlée au chant. Rien d’audacieux en revanche dans le cycle italianisant composé postérieurement par l’aîné Gounod (1818-1893) : on entend une guirlande de romances et de canzonette assez fades, au banal accompagnement chitarresco, d’ailleurs peu susceptibles d’être portées par les vers d’un certain Giuseppe Zaffira, d’une effarante platitude dans la syntaxe italienne qui, par moments, semble la traduction de gallicismes ! Les autres mélodies italiennes de Gounod, composées durant son séjour à Londres, ne changent rien à ce point de vue. Que dire des quelques pièces pour piano seul... mamma mia !... quand on pense que les pages pianistiques de Massenet ont pu être qualifiées de "salonnardes" !... mais elles sont à côté de celles-ci ce que la Hammerklavier est à une page "galante" ! Aucune imagination harmonique, aucun devenir du discours dans la composition, rien que mièvrerie ! Il faut dire que les interprètes ne font rien pour sauver ces mignardises : ils les traitent comme il fut en usage de traiter la musique française, c’est-à-dire en ne dépassant pas le registre de la grâce futile et en prenant avec des pincettes ces bibelots fragiles qui, croit-on, risqueraient de se briser si on les empoignait plus vigoureusement. On sait les méfaits commis à une certaine époque envers Massenet ou Fauré (et tant d’autres) à les considérer ainsi ! Par ailleurs, on se moque sans cesse de la prononciation des artistes lyriques étrangers chantant la musique française ; je crois bien que les Italiens auraient matière à nous retourner la pareille en écoutant David Lefort, dont les moyens s’inscrivent dans le profil type de ces voix dépourvues de projection formées au chant baroque et limitées, pour le répertoire postérieur, à la mélodie. Le piège réside dans le complément de programme, puisé chez Tosti (pour le coup, Gérard Condé commet une approximation en décrivant le compositeur italien comme « contemporain de Gounod », alors qu’il est son cadet d’une bonne génération, et le presque exact contemporain de Massenet, avec un strict décalage de 4 ans : Massenet, 1842-1912, Tosti, 1846-1916). Dieu sait que Tosti ne saurait passer pour un génie frappé du sceau de l’originalité, mais par rapport à Gounod, ses pages exhalent au moins des saveurs proches des mélodies écrites par les compositeurs (sommairement, voire improprement) dits "véristes" ; quant aux poèmes qu’elles illustrent, ils se tiennent, du point de vue de la langue italienne, à un niveau "convenable" si on les compare à l’ineffable Zaffira. Il manque à David Lefort la solaire vocalità d’un Italien (sans parler de ce que cela révèle de ses limites : aïe, le vers « Nina, rammenta » !), et Simon Zaoui oublie que le phrasé et les dynamiques de son accompagnement pianistique auraient pu évoquer des élans clairement issus de l’opéra italien.
René de Castéra : Trio op. 5 ; Lent et grave ; Sonate en mi op. 13. Ensemble Joseph Jongen (Eliot Lawson, Benjamin Glorieux, Diane Andersen). Vol. 1 de l’intégrale de la musique de chambre, Collection du Festival international Albert Roussel, RCP 075 (distr. Codaex).
 René de Castéra (1873-1955) présentait une élégante et fine silhouette d’hidalgo (landais), que des caricaturistes nous montraient volontiers escortant la volumineuse corpulence de la pianiste Blanche Selva ; mais qui connaît encore la musique de ce pilier de la Schola Cantorum, fidèle à son maître Vincent d’Indy ? Le croirait-on épigone de ses camarades scholistes plus choyés par la postérité que l’on se tromperait. Grâce à l’activité de producteur du chanteur et musicologue Damien Top (grand connaisseur des cycles de Massenet, lui !), on peut enfin goûter sa musique de chambre... et la révélation laisse fort ému. Dès le premier mouvement du Trio op. 5 (Lent), une atmosphère envoûtante nous empoigne, puis on s’achemine (Animé) vers les évolutions d’une écriture aussi nourrie que raffinée, laquelle investit généreusement l’espace. Le deuxième mouvement (Divertissement) introduit un élément folklorique, à la manière des amis scholistes Joseph Canteloube ou Déodat de Séverac. Le troisième mouvement (Assez lent) renoue avec cette expressivité dramatique au souffle profond qui nous avait saisis dès l’introduction. On retrouvera d’ailleurs les mêmes beautés dans le Lent et grave, mouvement isolé pour violoncelle et piano. Le final du Trio op. 5 (Assez animé) témoigne d’une âpre énergie, où l’élan est sous-tendu par les affleurements d’une volonté opiniâtre. Car un être humain fort attachant palpite derrière cette musique dense et personnelle. La Sonate pour violon et piano op. 13 suit une trace guère plus épigonale, même si l’ample chant demandé à l’archet nous évoque le courant franckiste, mais la richesse des textures n’apparaît jamais comme une fin en soi, elle traduit les mouvements d’un cœur sincère, l’originalité des mouvements harmoniques épouse la vie intérieure d’un esprit porté à la réflexion introspective. Lors du final, on remarque à nouveau ce ton obstiné dans l’énergie, qui semble un trait distinctif de René de Castéra. Parmi les interprètes, saluons tout particulièrement le violoncelliste Benjamin Glorieux, à la sonorité ample et chaleureuse. Toutefois, son talent ne requérait pas que la prise de son le "grossisse" trop artificiellement au premier plan, et l’on se demande parfois si la partie de piano, si mal servie microphoniquement et organologiquement (sans parler d’un accord approximatif de l’aigu !), n’est pas enregistrée dans une acoustique différente des cordes. On nous annonce le volume 2, gravé par les solistes de l’Orchestre du Metropolitan Opera dans un studio américain, gageons que ces soucis techniques nous seront alors épargnés. La notice rédigée par Damien Top dans un français délectable (eh oui, cela devient rare !) constitue une excellente introduction.
René de Castéra (1873-1955) présentait une élégante et fine silhouette d’hidalgo (landais), que des caricaturistes nous montraient volontiers escortant la volumineuse corpulence de la pianiste Blanche Selva ; mais qui connaît encore la musique de ce pilier de la Schola Cantorum, fidèle à son maître Vincent d’Indy ? Le croirait-on épigone de ses camarades scholistes plus choyés par la postérité que l’on se tromperait. Grâce à l’activité de producteur du chanteur et musicologue Damien Top (grand connaisseur des cycles de Massenet, lui !), on peut enfin goûter sa musique de chambre... et la révélation laisse fort ému. Dès le premier mouvement du Trio op. 5 (Lent), une atmosphère envoûtante nous empoigne, puis on s’achemine (Animé) vers les évolutions d’une écriture aussi nourrie que raffinée, laquelle investit généreusement l’espace. Le deuxième mouvement (Divertissement) introduit un élément folklorique, à la manière des amis scholistes Joseph Canteloube ou Déodat de Séverac. Le troisième mouvement (Assez lent) renoue avec cette expressivité dramatique au souffle profond qui nous avait saisis dès l’introduction. On retrouvera d’ailleurs les mêmes beautés dans le Lent et grave, mouvement isolé pour violoncelle et piano. Le final du Trio op. 5 (Assez animé) témoigne d’une âpre énergie, où l’élan est sous-tendu par les affleurements d’une volonté opiniâtre. Car un être humain fort attachant palpite derrière cette musique dense et personnelle. La Sonate pour violon et piano op. 13 suit une trace guère plus épigonale, même si l’ample chant demandé à l’archet nous évoque le courant franckiste, mais la richesse des textures n’apparaît jamais comme une fin en soi, elle traduit les mouvements d’un cœur sincère, l’originalité des mouvements harmoniques épouse la vie intérieure d’un esprit porté à la réflexion introspective. Lors du final, on remarque à nouveau ce ton obstiné dans l’énergie, qui semble un trait distinctif de René de Castéra. Parmi les interprètes, saluons tout particulièrement le violoncelliste Benjamin Glorieux, à la sonorité ample et chaleureuse. Toutefois, son talent ne requérait pas que la prise de son le "grossisse" trop artificiellement au premier plan, et l’on se demande parfois si la partie de piano, si mal servie microphoniquement et organologiquement (sans parler d’un accord approximatif de l’aigu !), n’est pas enregistrée dans une acoustique différente des cordes. On nous annonce le volume 2, gravé par les solistes de l’Orchestre du Metropolitan Opera dans un studio américain, gageons que ces soucis techniques nous seront alors épargnés. La notice rédigée par Damien Top dans un français délectable (eh oui, cela devient rare !) constitue une excellente introduction.
Max d’Ollone : Trio en la mineur, Six études de concert, Danse des fées, Minuetto, Petite suite. Dimitris Saroglu (piano), Gérard Poulet (violon), Dominique de Williencourt (violoncelle). Europe & Art EA 1110 (distr. Intégral).
 Compositeur contemporain du précédent, aristocrate comme lui, Max d’Ollone (1875-1959) fut un brillant élève de Massenet. On connaissait, grâce à la collection de Didier Henry chez Maguelone, ses mélodies. Le label suisse Claves nous avait donné de très belles pages orchestrales et concertantes. À nouveau un Trio pour piano, violon et violoncelle (1920), au programme du disque qui nous parvient aujourd’hui, avec Gérard Poulet à la place de son père Gaston Poulet qui assura la création de l’œuvre : franche richesse de l’écriture, fluidité des lignes mélodiques (les deux premiers mouvements), rebondissante vivacité (les deux derniers mouvements) se conjuguent harmonieusement, mais quel dommage que cette exécution (qui d’ailleurs ne montre pas les interprètes à leur meilleur) soit gâchée par une prise de son aberrante, étriquée, gommant l’acoustique de la petite église où elle fut réalisée !
Suit un florilège de pièces pour piano, entachées de faiblesses d’inspiration, et handicapées par une interprétation... dénuée d’inspiration. L’exhumation, cette fois, n’apportait rien !
Compositeur contemporain du précédent, aristocrate comme lui, Max d’Ollone (1875-1959) fut un brillant élève de Massenet. On connaissait, grâce à la collection de Didier Henry chez Maguelone, ses mélodies. Le label suisse Claves nous avait donné de très belles pages orchestrales et concertantes. À nouveau un Trio pour piano, violon et violoncelle (1920), au programme du disque qui nous parvient aujourd’hui, avec Gérard Poulet à la place de son père Gaston Poulet qui assura la création de l’œuvre : franche richesse de l’écriture, fluidité des lignes mélodiques (les deux premiers mouvements), rebondissante vivacité (les deux derniers mouvements) se conjuguent harmonieusement, mais quel dommage que cette exécution (qui d’ailleurs ne montre pas les interprètes à leur meilleur) soit gâchée par une prise de son aberrante, étriquée, gommant l’acoustique de la petite église où elle fut réalisée !
Suit un florilège de pièces pour piano, entachées de faiblesses d’inspiration, et handicapées par une interprétation... dénuée d’inspiration. L’exhumation, cette fois, n’apportait rien !
Émile Goué : 1) Les 3 Quatuors à cordes, par le Quatuor César Franck. RCP 067.
2) L’œuvre pour piano, vol. 2, par Diane Andersen. AZC 083.
Collection du Festival international Albert Roussel (distr. Codaex).
 Cadet dans la chronologie des exhumations que nous considérons ici, Émile Goué (1904-1946) connut le sort tragique d’un destin fauché par les séquelles de son séjour de cinq ans à l’Oflag XB (il avait été fait prisonnier dès 1940). Personnalité atypique que cet agrégé de physique, professeur de Mathématiques spéciales, dont l’idéal incorruptible se manifestait à travers la musique. Semblant physiquement taillé dans le roc – cette vigoureuse stature ne suffit pas à le préserver des mauvais traitements –, il nous laisse une musique (injustement méconnue) à son image, austère mais si profondément imprégnée des valeurs humaines chères à leur auteur qu’elle n’en ressemble à nulle autre. Damien Top, dans les collections du Festival Albert Roussel, lui réserve une série de premiers enregistrements mondiaux (mélodies, musique de chambre), parmi lesquels le disque des trois quatuors à cordes laisse une forte impression, en symbiose avec l’émotion partagée par les interprètes. Le quatuor de 1936-37 dénotait déjà un contrepoint exigeant, à l’oeuvre dès avant l’incarcération à l’Oflag (l’insatisfait musicien le révisa pourtant derrière les barbelés, en 1943) : le naturel d’Émile Goué ne le portait pas à l’esprit badin mais, quand la survie spirituelle, au cours de cinq années d’incarcération, se sustente par la composition d’une vingtaine d’œuvres (souvent de vastes proportions), la futilité ne s’installe guère dans le processus mental ! Les mouvements lents des quatuors reflètent de manière vibrante la quête existentielle de leur auteur. On assiste autant au mûrissement technique qu’au cheminement intérieur d’Émile Goué à travers ces trois ouvrages. Le deuxième, écrit en captivité, témoigne d’une fluidité accrue dans l’écriture, et son mouvement lent épure les lignes, comme si les chants entrecroisés visaient au détachement pour mieux remplir leur mission d’adresser un « murmure d’amour et d’espoir » à l’épouse demeurée au loin. Le final se hisse à un nouveau seuil d’accomplissement, inquiet bruissement interrompu par des rais de lumière où chante le 1er violon : on reste saisi par l’accession à la sérénité vers laquelle tend le prisonnier. Le 3ème quatuor naît alors que la période de captivité durait déjà depuis quatre ans et demi : le premier mouvement commence dans une intime désolation qui n’est pas sans évoquer certaines confidences musicales de Chostakovitch, mais un étonnant sursaut vers la vitalité triomphe au fil de la construction. La maîtrise de l’écriture a désormais évacué les imperfections sur lesquelles butaient par moments le discours des deux précédentes oeuvres. Le 2ème mouvement, par ses surprenantes rencontres harmoniques résultant du contrepoint, est un chef-d’œuvre de force expressive d’où la lumière du détachement ne s’abstrait jamais. S’y manifeste la force intérieure grâce à laquelle le compositeur endura l’épreuve. Un contrepoint très germanique sous-tend le 3ème mouvement, avec un usage obsessionnel de quelques cellules ; des graves de l’ensemble surgit par moments une émotion poignante. Qu’eût-il donné, ce compositeur assidûment perfectionniste, s’il n’eût été privé des étapes de la grande maturité ?
Cadet dans la chronologie des exhumations que nous considérons ici, Émile Goué (1904-1946) connut le sort tragique d’un destin fauché par les séquelles de son séjour de cinq ans à l’Oflag XB (il avait été fait prisonnier dès 1940). Personnalité atypique que cet agrégé de physique, professeur de Mathématiques spéciales, dont l’idéal incorruptible se manifestait à travers la musique. Semblant physiquement taillé dans le roc – cette vigoureuse stature ne suffit pas à le préserver des mauvais traitements –, il nous laisse une musique (injustement méconnue) à son image, austère mais si profondément imprégnée des valeurs humaines chères à leur auteur qu’elle n’en ressemble à nulle autre. Damien Top, dans les collections du Festival Albert Roussel, lui réserve une série de premiers enregistrements mondiaux (mélodies, musique de chambre), parmi lesquels le disque des trois quatuors à cordes laisse une forte impression, en symbiose avec l’émotion partagée par les interprètes. Le quatuor de 1936-37 dénotait déjà un contrepoint exigeant, à l’oeuvre dès avant l’incarcération à l’Oflag (l’insatisfait musicien le révisa pourtant derrière les barbelés, en 1943) : le naturel d’Émile Goué ne le portait pas à l’esprit badin mais, quand la survie spirituelle, au cours de cinq années d’incarcération, se sustente par la composition d’une vingtaine d’œuvres (souvent de vastes proportions), la futilité ne s’installe guère dans le processus mental ! Les mouvements lents des quatuors reflètent de manière vibrante la quête existentielle de leur auteur. On assiste autant au mûrissement technique qu’au cheminement intérieur d’Émile Goué à travers ces trois ouvrages. Le deuxième, écrit en captivité, témoigne d’une fluidité accrue dans l’écriture, et son mouvement lent épure les lignes, comme si les chants entrecroisés visaient au détachement pour mieux remplir leur mission d’adresser un « murmure d’amour et d’espoir » à l’épouse demeurée au loin. Le final se hisse à un nouveau seuil d’accomplissement, inquiet bruissement interrompu par des rais de lumière où chante le 1er violon : on reste saisi par l’accession à la sérénité vers laquelle tend le prisonnier. Le 3ème quatuor naît alors que la période de captivité durait déjà depuis quatre ans et demi : le premier mouvement commence dans une intime désolation qui n’est pas sans évoquer certaines confidences musicales de Chostakovitch, mais un étonnant sursaut vers la vitalité triomphe au fil de la construction. La maîtrise de l’écriture a désormais évacué les imperfections sur lesquelles butaient par moments le discours des deux précédentes oeuvres. Le 2ème mouvement, par ses surprenantes rencontres harmoniques résultant du contrepoint, est un chef-d’œuvre de force expressive d’où la lumière du détachement ne s’abstrait jamais. S’y manifeste la force intérieure grâce à laquelle le compositeur endura l’épreuve. Un contrepoint très germanique sous-tend le 3ème mouvement, avec un usage obsessionnel de quelques cellules ; des graves de l’ensemble surgit par moments une émotion poignante. Qu’eût-il donné, ce compositeur assidûment perfectionniste, s’il n’eût été privé des étapes de la grande maturité ?
Le Quatuor César Franck émane des rangs de l’Opéra Royal de Wallonie, mais les membres sont, qui polonais, qui tchèque, qui morave, et le violoncelliste vient du Mexique ! On ne s’étonnera donc pas que d’autres critiques aient noté des relents mittel-européens dans les rythmes et la "griffe" d’Émile Goué : les interprètes ont saisi de telles affinités musicales avec leurs "dialectes" natifs qu’ils se les sont incorporées. De fait, Émile Goué exaltait les valeurs de l’art français, mais son style l’apparentait à une facture d’obédience plutôt germanique et à une puissance rythmique s’alimentant plus encore à l’est, n’était la présence atypique de Roussel dans l’école française. La prise de son s’avère ici convaincante.
Un premier volume de pièces pour piano avait été gravé par Samuel Temoy, un deuxième ressuscite sous les doigts de Diane Andersen des pièces imprégnées de la modalité et de la polytonalité par lesquelles Émile Goué voyait s’ouvrir un champ d’extension de la tonalité à qui saurait labourer la combinatoire contrapuntique et les surprises des rencontres harmoniques. C’est pourquoi la référence à l’influence debussyste pointée par Philippe Malhaire dans sa (par ailleurs) pertinente introduction résiste mal à l’analyse: on peut même se demander si les quasi-citations traversant le final d’une œuvre allusivement titrée Prélude, Aria et Final (op. 45, 1944) ne seraient pas à prendre comme un clin d’œil ; Debussy se faufilant chez César Franck, quelle malice quand on sait les rapports entre le maître et l’élève lors du fugitif passage que Claude de France effectua à la classe d’orgue pour apprendre l’improvisation (« Modulez, modulez ! » criait le chantre des damassures chromatiques au soyeux novateur de l’harmonie des impondérables) ! Pour le reste, on serait bien en peine de rattacher le langage d’Émile Goué à qui que ce soit (peut-être une filiation avec Roussel, auprès duquel il prit quelques leçons avant de s’en aller étudier chez Charles Koechlin, de par l’âpreté rythmique et la vigoureuse découpe du discours ?). La gravité sous-jacente que l’on perçoit dans des formes très contrôlées mais ouvertes aux évolutions inattendues qu’engendre l’indépendance des courbes, l’isolement (forcé !) par rapport au monde musical ambiant, tout ceci confère aux rudes sculptures sonores de Goué (on pense au style du peintre Gromaire, parfois) un caractère qui convainc par sa sincérité sans concessions. L’écoute continue d’une heure et quart de musique pour piano n’est peut-être pas un service à lui rendre, d’autant que Diane Andersen (qui se pencha par exemple sur la musique de Darius Milhaud) aime souligner les arêtes au burin, alors que des flambées de lyrisme, fécondées par une vie intérieure qui lui semble étrangère, pourraient avantageusement rompre le cercle d’une certaine monotonie qu’engendre une telle lecture. De surcroît, le plaisir acoustique pâtit encore une fois du piano sis dans le studio belge où enregistre le producteur, piano que l’on qualifierait volontiers "d’impropre à la consommation". On conseille donc de revenir individuellement sur chaque recueil, pour mieux en observer la trame très élaborée au tissage serré.
L’altiste Pierre Lénert
Lors d’une soirée Intégral au Foyer du Châtelet le 10 février 2012, l’altiste Pierre Lénert présentait sa discographie, en donnant un bref concert avec la pianiste Éliane Reyes où les émotions crépusculaires prédominaient, puisque les Märchenbilder op. 113 (1851) de Schumann précédaient l’ultime Sonate de Chostakovitch, l’op. 147 pour alto et piano (1975), véritable expérience existentielle pour les interprètes appelés à s’investir dans cet adieu à la vie laissé par un compositeur se sachant parvenu au terme et se retournant d’un regard déjà voilé par l’au-delà sur les épreuves de son parcours hérissé de confrontations avec l’Histoire. Le décès subit de l’agent de Pierre Lénert venait imprimer une touche de deuil supplémentaire à ce moment intense.
Une composition aussi chargée de sens que l’op. 147 de Chostakovitch renvoie à trop d’interrogations intimes sur la vie et la mort pour ne pas se prêter à des interprétations différentes selon la nature profonde des individus s’y plongeant corps et âme. Cet été, à Wissembourg, on avait entendu Arnaud Thorette, avec Finghin Collins qui l’escortait dans cette raréfaction de la matière sonore, en donner une interprétation sur le fil, désincarnée, déjà fantomatique. D’un tempérament plus sanguin, Pierre Lénert vivait cette œuvre sur le registre tragique d’une douleur encore ancrée dans un ressenti de chair ; lui aussi se trouvait suivi dans ses intentions par une attentive partenaire au jeu... précisément charnu : Eliane Reyes montra toutes les qualités d’une chambriste par son art de sertir l’immense monologue émanant de l’âme de l’alto. Le disque, on va le constater, ne le cède en rien à la présence du concert.
Chostakovitch : Sonate pour violoncelle et piano op. 40, transcrite à l’alto par Pierre Lénert ; Sonate pour alto et piano op. 147. Pierre Lénert (alto), Eliane Reyes (piano). Intégral INT 221.243.
 Devant les micros comme en public, le dépouillement, chez Pierre Lénert, demeure incarné, la tension de l’achèvement vibre en refusant de se résigner. Eliane Reyes va chercher dans de beaux graves de quoi l’étayer avec substance malgré une trame de touches raréfiées. Le premier mouvement exacerbe le cri d’adieu. Mais l’allusion au passé resurgit dans le mouvement central : une grinçante réutilisation par Chostakovitch d’une musique ébauchée dans sa jeunesse (pour Les Joueurs de Gogol) s’affronte à un éloignement vers le désert tandis que les graves des deux instruments martèlent l’inexorable à l’approche du gouffre. L’immense thrène final révèle l’interprète, qui s’y trouve mis à nu ; Pierre Lénert exhale le solo initial du plus profond de son être ; loin de désincarner la déploration qui s’élève de ce mouvement d’un quart d’heure, il lui infuse une sombre puissance d’une présence irradiante. Aux prises avec l’hommage désarticulé à la Sonate au Clair de Lune de Beethoven, Eliane Reyes charge de sens le dépouillement des notes égrenées dans les zones écartelées du clavier. On entend là un chant d’alto qui embrasse d’un ample geste ultime l’humanité souffrante, et porte avec une farouche grandeur la volonté d’un destin jusqu’au morendo final.
Devant les micros comme en public, le dépouillement, chez Pierre Lénert, demeure incarné, la tension de l’achèvement vibre en refusant de se résigner. Eliane Reyes va chercher dans de beaux graves de quoi l’étayer avec substance malgré une trame de touches raréfiées. Le premier mouvement exacerbe le cri d’adieu. Mais l’allusion au passé resurgit dans le mouvement central : une grinçante réutilisation par Chostakovitch d’une musique ébauchée dans sa jeunesse (pour Les Joueurs de Gogol) s’affronte à un éloignement vers le désert tandis que les graves des deux instruments martèlent l’inexorable à l’approche du gouffre. L’immense thrène final révèle l’interprète, qui s’y trouve mis à nu ; Pierre Lénert exhale le solo initial du plus profond de son être ; loin de désincarner la déploration qui s’élève de ce mouvement d’un quart d’heure, il lui infuse une sombre puissance d’une présence irradiante. Aux prises avec l’hommage désarticulé à la Sonate au Clair de Lune de Beethoven, Eliane Reyes charge de sens le dépouillement des notes égrenées dans les zones écartelées du clavier. On entend là un chant d’alto qui embrasse d’un ample geste ultime l’humanité souffrante, et porte avec une farouche grandeur la volonté d’un destin jusqu’au morendo final.
On abordait, avouons-le, en traînant des pieds la transcription de la Sonate op. 40, tant on aime le violoncelle en général et la version "authentique" de cette Sonate en particulier. Et – ô divine surprise – on se trouve emporté dans l’une des plus bouleversantes interprétations de cet autre chef-d’œuvre, l’une des plus accomplies aussi quant au travail du son : Pierre Lénert modèle en ronde bosse le chant de son alto, et donne à chaque timbre requis l’étoffe adéquate. Couleurs ambrées, couleurs radieuses, gambades mordantes, blancheurs lunaires à la frontière du risque au voisinage du ponticello, et imagination débridée dans l’irisation des fameux glissandi en harmoniques du scherzo : tout ici consacre la suprématie d’un alto en majesté que la prise de son de Sébastien Noly restitue avec une remarquable fidélité ; cette fois, le piano pâtit d’être enregistré au second plan, mais les aigus de l’instrument à marteaux sonnant avec dureté, on se prend à ne pas trop le regretter ; et puis, reconnaissons que l’autorité de Pierre Lénert mène la danse et draine tout naturellement l’attention.
Il nous captive en nous offrant un des plus beaux disques d’alto que l’on puisse entendre.
Beethoven : Notturno op. 42 (arr. William Primrose), pour alto et piano ; Duo mit zwei obligaten Augengläsern, pour alto et violoncelle ; Sérénade op. 25, pour flûte, violon et alto. Pierre Lénert (alto), Jeff Cohen (piano), Cyril Lacrouts (violoncelle), Frédéric Laroque (violon), Patrick Gallois (flûte). Intégral INT 221.141.
 Si, au sortir de cette traversée crépusculaire, une soif de jeunesse vous prend, le précédent disque du même Pierre Lénert vous apportera une vague rafraîchissante. Y sont regroupées des œuvres écrites dans l’esprit du "divertissement" (c’est à ce genre du XVIIIème siècle, déjà menacé de désuétude, que les trois titres se réfèrent encore) par un jeune Beethoven en quête de reconnaissance, mais, abordées avec une franche tonicité comme par les interprètes du présent enregistrement, elles plaisent grâce à la diversité de ton que les alliages instrumentaux suggèrent. Attention, l’ordre entendu sur le disque est exactement inverse de celui imprimé sur le livret ! On notera que, fidèle à une constante de son génie, Beethoven insère des variations dans le Notturno et la Sérénade, et s’y montre un jeune maître, dépassant le propos quelque peu décoratif de telles musiques. Le souffle d’une inspiration véritable est à chercher dans les deux derniers mouvements du Notturno (le Tema con Variazioni, précisément, suivies d’un bref Andante quasi allegretto, comme un postlude expressif après le vaste mouvement précédent), un arrangement d’époque (revu par le grand altiste écossais William Primrose) à partir de la Sérénade op. 8 que Beethoven destinait au trio à cordes : le pur tracé des lignes originelles commande le geste souple et généreux par lequel Pierre Lénert et Jeff Cohen gouvernent harmonieusement l’envolée de ces pages. Quant à l’accélération finale de la Sérénade op. 25 pour trois "dessus" (l’alto représentant la voix la plus grave, cette fois), elle rebondit irrésistiblement, terminant le disque dans la jovialité.
Si, au sortir de cette traversée crépusculaire, une soif de jeunesse vous prend, le précédent disque du même Pierre Lénert vous apportera une vague rafraîchissante. Y sont regroupées des œuvres écrites dans l’esprit du "divertissement" (c’est à ce genre du XVIIIème siècle, déjà menacé de désuétude, que les trois titres se réfèrent encore) par un jeune Beethoven en quête de reconnaissance, mais, abordées avec une franche tonicité comme par les interprètes du présent enregistrement, elles plaisent grâce à la diversité de ton que les alliages instrumentaux suggèrent. Attention, l’ordre entendu sur le disque est exactement inverse de celui imprimé sur le livret ! On notera que, fidèle à une constante de son génie, Beethoven insère des variations dans le Notturno et la Sérénade, et s’y montre un jeune maître, dépassant le propos quelque peu décoratif de telles musiques. Le souffle d’une inspiration véritable est à chercher dans les deux derniers mouvements du Notturno (le Tema con Variazioni, précisément, suivies d’un bref Andante quasi allegretto, comme un postlude expressif après le vaste mouvement précédent), un arrangement d’époque (revu par le grand altiste écossais William Primrose) à partir de la Sérénade op. 8 que Beethoven destinait au trio à cordes : le pur tracé des lignes originelles commande le geste souple et généreux par lequel Pierre Lénert et Jeff Cohen gouvernent harmonieusement l’envolée de ces pages. Quant à l’accélération finale de la Sérénade op. 25 pour trois "dessus" (l’alto représentant la voix la plus grave, cette fois), elle rebondit irrésistiblement, terminant le disque dans la jovialité.
Georges Enesco : Concertstück pour alto et piano ; Jean Françaix : Rhapsodie pour alto et piano ; Darius Milhaud : Les quatre visages, 1ère et 2ème Sonates. Pierre Lénert (alto), Cédric Tiberghien (piano). Intégral INSO 221.335.
 Ne terminons pas cette chronique sans rappeler une gravure plus ancienne (enregistrée en mars 2006) au programme constitué de raretés. Ce disque nous reste cher car il montrait Pierre Lénert en récitaliste déployant une palette égale à celle d’un violoniste – on ne saurait mieux dire, pour défendre la capacité de l’alto à s’affirmer comme "individu" à part entière ! – , et de surcroît secondé par un partenaire vigoureux, sensible, à l’intelligence toujours affûtée, le valeureux pianiste Cédric Tiberghien. Dès les premières mesures d’une pièce qu’Enesco destina au concours d’alto du Conservatoire de Paris, mais qui n’en porte pas moins le lyrisme à fleur d’archet propre au fameux violoniste roumain, le son enveloppant de Pierre Lénert s’empare de l’auditeur et ne relâchera plus son charme. La fantaisie délicieusement exubérante de Jean Françaix permet à l’altiste de mettre en lumière d’autres facettes de sa virtuosité. Les œuvres de la période d’exil (1943-44) de Darius Milhaud véhiculent encore des flaveurs de musique française d’avant-guerre, doublées d’un penchant avoué au classicisme à peine "néo-" (les pastiches titrés Française et Final dans la 1ère Sonate sont d’ailleurs plus redevables envers l’écriture de Bach qu’au baroque français !). Ceci dit, elles offrent un champ séduisant à l’expression mélodique de l’instrument : Pierre Lénert épanche sa merveilleuse sensibilité dans l’émotion de La Bruxelloise ou dans l’Air joué avec sourdine. La 2ème Sonate, par ses traits contrastés, franchit plus aisément la barrière du temps, notamment grâce au mouvement Dramatique très prenant, suivi d’un Rude, sorte d’Allegro barbaro de la meilleure veine (que Charles-Valentin Alkan et Bartók nous pardonnent l’emprunt).
En rapprochant ce récital de musique française du nouveau disque Chostakovitch, on tient un formidable et très complet portrait de Pierre Lénert en interprète du XXème siècle.
Ne terminons pas cette chronique sans rappeler une gravure plus ancienne (enregistrée en mars 2006) au programme constitué de raretés. Ce disque nous reste cher car il montrait Pierre Lénert en récitaliste déployant une palette égale à celle d’un violoniste – on ne saurait mieux dire, pour défendre la capacité de l’alto à s’affirmer comme "individu" à part entière ! – , et de surcroît secondé par un partenaire vigoureux, sensible, à l’intelligence toujours affûtée, le valeureux pianiste Cédric Tiberghien. Dès les premières mesures d’une pièce qu’Enesco destina au concours d’alto du Conservatoire de Paris, mais qui n’en porte pas moins le lyrisme à fleur d’archet propre au fameux violoniste roumain, le son enveloppant de Pierre Lénert s’empare de l’auditeur et ne relâchera plus son charme. La fantaisie délicieusement exubérante de Jean Françaix permet à l’altiste de mettre en lumière d’autres facettes de sa virtuosité. Les œuvres de la période d’exil (1943-44) de Darius Milhaud véhiculent encore des flaveurs de musique française d’avant-guerre, doublées d’un penchant avoué au classicisme à peine "néo-" (les pastiches titrés Française et Final dans la 1ère Sonate sont d’ailleurs plus redevables envers l’écriture de Bach qu’au baroque français !). Ceci dit, elles offrent un champ séduisant à l’expression mélodique de l’instrument : Pierre Lénert épanche sa merveilleuse sensibilité dans l’émotion de La Bruxelloise ou dans l’Air joué avec sourdine. La 2ème Sonate, par ses traits contrastés, franchit plus aisément la barrière du temps, notamment grâce au mouvement Dramatique très prenant, suivi d’un Rude, sorte d’Allegro barbaro de la meilleure veine (que Charles-Valentin Alkan et Bartók nous pardonnent l’emprunt).
En rapprochant ce récital de musique française du nouveau disque Chostakovitch, on tient un formidable et très complet portrait de Pierre Lénert en interprète du XXème siècle.
Samuel Barber côté cordes et côté clavier
Aram Khatchaturian : Concerto pour violon (cadenza d’Artur Avanesov). Samuel Barber : Concerto pour violon op. 14 ; Adagio pour cordes op. 11. Mikhail Simonyan, London Symphony Orchestra, dir. Kristjan Järvi. DGG 477 9827.
 Deutsche Grammophon lance un nouveau talent issu de l’école russe, et le disque reçoit pour titre : "Two souls" (Deux âmes), puisqu’il associe un concerto arménien (symbolisant les racines du violoniste) et un concerto américain (pour honorer la terre de formation du jeune homme). Des commentaires de presse comparent abusivement Mikhail Simonyan à David Oïstrakh, au prétexte qu’il a étudié auprès d’un élève du "Roi David" : allons, allons, un peu de mesure, la somptueuse rondeur de la sonorité du maître disparu, son style à l’ample souffle mélodique demeurent hors de portée ! Du reste, le nouveau venu n’a pas besoin d’échelles comparatives, il affirme déjà une personnalité bien autonome, dotée d’un jeu sensible et lumineux qui nous comble dans les œuvres ici présentées. On rencontrera l’un des plus parlants exemples de cette chaleureuse musicalité dans le mouvement lent du concerto de Khatchaturian, cantilène nostalgique que chantent d’un même cœur le soliste et le chef. Pour le reste, que dire de la (bruyante) musique de Khatchaturian qui, en aucune époque, ne sut être contemporaine de quoi que ce soit, et pas même de son auteur ! La partie la plus originale de la version ici proposée réside dans la longue cadence (5 minutes) que Mikhail Simonyan a commandée à Artur Avanesov afin d’apporter une touche plus "ethniquement" arménienne par la référence à l’ancestrale modalité du patrimoine religieux : une réussite artistique, vraiment, et une démonstration, autant de sensibilité que de virtuosité ; du coup, le retour orchestral au "vrai" Khatchaturian rompt le charme ! Situation inédite où une cadenza supplante en valeur musicale l’œuvre proprement dite ! Une prise de son en technicolor correspond au style de direction fort américanisé de Kristjan Järvi, tantôt d’une vigueur hyper-incisive, tantôt d’un sentimentalisme caressant, auquel le LSO répond avec une flamme jubilatoire.
Deutsche Grammophon lance un nouveau talent issu de l’école russe, et le disque reçoit pour titre : "Two souls" (Deux âmes), puisqu’il associe un concerto arménien (symbolisant les racines du violoniste) et un concerto américain (pour honorer la terre de formation du jeune homme). Des commentaires de presse comparent abusivement Mikhail Simonyan à David Oïstrakh, au prétexte qu’il a étudié auprès d’un élève du "Roi David" : allons, allons, un peu de mesure, la somptueuse rondeur de la sonorité du maître disparu, son style à l’ample souffle mélodique demeurent hors de portée ! Du reste, le nouveau venu n’a pas besoin d’échelles comparatives, il affirme déjà une personnalité bien autonome, dotée d’un jeu sensible et lumineux qui nous comble dans les œuvres ici présentées. On rencontrera l’un des plus parlants exemples de cette chaleureuse musicalité dans le mouvement lent du concerto de Khatchaturian, cantilène nostalgique que chantent d’un même cœur le soliste et le chef. Pour le reste, que dire de la (bruyante) musique de Khatchaturian qui, en aucune époque, ne sut être contemporaine de quoi que ce soit, et pas même de son auteur ! La partie la plus originale de la version ici proposée réside dans la longue cadence (5 minutes) que Mikhail Simonyan a commandée à Artur Avanesov afin d’apporter une touche plus "ethniquement" arménienne par la référence à l’ancestrale modalité du patrimoine religieux : une réussite artistique, vraiment, et une démonstration, autant de sensibilité que de virtuosité ; du coup, le retour orchestral au "vrai" Khatchaturian rompt le charme ! Situation inédite où une cadenza supplante en valeur musicale l’œuvre proprement dite ! Une prise de son en technicolor correspond au style de direction fort américanisé de Kristjan Järvi, tantôt d’une vigueur hyper-incisive, tantôt d’un sentimentalisme caressant, auquel le LSO répond avec une flamme jubilatoire.
Certes, le concerto de Barber n’incline pas à l’avant-garde, mais il témoigne d’une personnalité infiniment plus distinguée, plus raffinée, qui garantit par-delà les générations la persistance d’une appréciable jouissance d’écoute. Au cours de la seule année 2011, on l’entendit trois fois à Paris (après une si longue absence ! Incohérence des programmateurs...) : d’un lyrisme de rhapsode par Nemanja Radulovic, accompagné de l’Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de Steuart Bedford, d’un élan plein de panache par Lisa Batiashvili et David Zinman au National, d’une décevante absence de séduction par Gil Shaham et un James Conlon plutôt vulgaire à l’Orchestre de Paris. Dans la notice, Mikhail Simonyan se targue d’avoir bridé la course du moto perpetuo final : en fait, ce n’est guère l’effet ressenti, car ce final demeure extrêmement bref après l’étirement des tempi qu’il impose... aux deux premiers mouvements. Il veut le premier mouvement rêveur, et sollicite le tempo en ce sens : on peut contester cette option, mais il la soutient avec grâce, ce qui lui donne des arguments. Pourtant, au 2ème mouvement, encore plus excessivement alangui, on réalise que la valeur de contraste entre les deux volets s’en trouve gommée, et c’est dommage. Le tempo adopté pour le mouvement central fait ressortir un esprit post-romantique viennois qui prépare, il est vrai, au caractère franchement post-mahlerien de l’Adagio op. 11, de peu antérieur au catalogue de Samuel Barber. Ceci dit, la sonorité idéalement translucide de Mikhail Simonyan rayonne sur toute l’œuvre.
Pour conclure, Kristjan Järvi conduit une admirable gradation dans l’Adagio, reposant sur une gestion mûrement pensée du temps : il va chercher la première exposition loin, très loin, au fond des nuances et des abîmes de ses pupitres ; il étire à son tour le tempo pour en extraire le dessin le plus pur puis monter l’arche et la tension expressive très progressivement. Après le climax, on ne retombe que plus profond pour une fin sublimée. Une version bien personnelle, assurément.
Ce disque (enregistré du 30 mai au 1er juin 2011) a bénéficié du soutien financier des Galeries Lafayette de Berlin, et d’un magazine arménien (Yerevan) : décidément, la marque à l’étiquette jaune n’est plus ce qu’elle était, et ne produit même plus sur ses seuls subsides un disque "grand public" comme celui-ci...
Samuel Barber : L’œuvre pour piano. Leon McCawley. Somm CD 0108 (distr. Codaex).
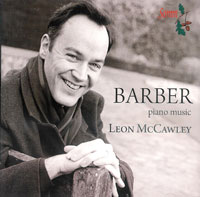 Le pianiste britannique Leon McCawley avait déjà gravé pour Virgin une quasi-intégrale de l’oeuvre pour piano de Barber (un disque de 1997), et s’installait alors au sommet de la discographie par sa finesse poétique et son intime compréhension des multiples facettes d’un compositeur qui nous laisse un corpus pianistique, certes réduit par la quantité, mais d’une séduction unique et décomplexée. Tout juste pouvait-on reprocher au pianiste de privilégier par moments la délicatesse sur la densité du travail sonore. Les 27 et 28 septembre 2010, il remettait l’ouvrage sur le métier pour le label anglais Somm. Doit-on rejeter l’ancienne version au profit de la nouvelle ? L’écoute comparative nous conduit à des conclusions plus nuancées. Tout d’abord, il a accéléré nombre de ses tempi, ce dont on inférera que le manque de densité déjà noté ne se trouve en rien résolu : écoutez la Ballade op. 46, pièce tardive et lourde d’une affliction que le contexte biographique du compositeur induisait ; la version de 2010, prise à un tempo plus allant, verse dans une certaine superficialité, alors qu’en 1997, le pianiste en épousait la gravité introvertie ; de surcroît, la captation des registres de la version Somm offre une moins bonne définition. La plus cruelle déception vient du chef-d’œuvre, la Sonate : l’interprétation de 2010 a notablement perdu en envergure pianistique et en relief des contrastes (la remarque vaut pour chacun des mouvements, si puissamment caractérisés) par rapport à celle de 1997, quasiment idéale (n’oublions pas un prédécesseur illustre, nommé Vladimir Horowitz !) et mieux enregistrée. En revanche, le McCawley d’aujourd’hui saisit avec une plénitude accrue le mystère du premier Interlude posthume (1931), et le complète par un deuxième Interlude de la même période, publié depuis, qui se déchaîne en toccata. À propos d’exhumations, remonter plus loin dans le temps en gravant les trois bluettes salonnardes commises par un gamin de 14 ans, ne s’imposait pas ! Le Nocturne, malicieusement sous-titré Hommage à John Field, alors qu’il en offre un détournement truffé de contrepoint polytonal et d’intrusions dodécaphoniques, sonne avec des timbres plus intéressants dans l’interprétation de 2010 qui en souligne les élégantes allusions à Chopin. Les Excursions, écrites pendant la guerre, constituaient le maillon faible du premier disque ; depuis, le sujet de Sa Gracieuse Majesté a pris la peine de décrypter les inimitables saveurs des genres populaires américains (boogie woogie, slow blues, ballade western, country music) autour desquels Barber a brodé d’ingénieuses variations. À l’inverse, la caractérisation des danses de salon réunies dans l’humoristique recueil Souvenirs op. 28 a perdu de la verve dont on se régalait en 1997 ; de plus, la définition compacte du nouvel enregistrement va jusqu’à rendre incompréhensibles les contre-harmonies (presque des mini-clusters) par lesquelles Barber torpille le thème bien typé de son Hesitation-Tango.
Le pianiste britannique Leon McCawley avait déjà gravé pour Virgin une quasi-intégrale de l’oeuvre pour piano de Barber (un disque de 1997), et s’installait alors au sommet de la discographie par sa finesse poétique et son intime compréhension des multiples facettes d’un compositeur qui nous laisse un corpus pianistique, certes réduit par la quantité, mais d’une séduction unique et décomplexée. Tout juste pouvait-on reprocher au pianiste de privilégier par moments la délicatesse sur la densité du travail sonore. Les 27 et 28 septembre 2010, il remettait l’ouvrage sur le métier pour le label anglais Somm. Doit-on rejeter l’ancienne version au profit de la nouvelle ? L’écoute comparative nous conduit à des conclusions plus nuancées. Tout d’abord, il a accéléré nombre de ses tempi, ce dont on inférera que le manque de densité déjà noté ne se trouve en rien résolu : écoutez la Ballade op. 46, pièce tardive et lourde d’une affliction que le contexte biographique du compositeur induisait ; la version de 2010, prise à un tempo plus allant, verse dans une certaine superficialité, alors qu’en 1997, le pianiste en épousait la gravité introvertie ; de surcroît, la captation des registres de la version Somm offre une moins bonne définition. La plus cruelle déception vient du chef-d’œuvre, la Sonate : l’interprétation de 2010 a notablement perdu en envergure pianistique et en relief des contrastes (la remarque vaut pour chacun des mouvements, si puissamment caractérisés) par rapport à celle de 1997, quasiment idéale (n’oublions pas un prédécesseur illustre, nommé Vladimir Horowitz !) et mieux enregistrée. En revanche, le McCawley d’aujourd’hui saisit avec une plénitude accrue le mystère du premier Interlude posthume (1931), et le complète par un deuxième Interlude de la même période, publié depuis, qui se déchaîne en toccata. À propos d’exhumations, remonter plus loin dans le temps en gravant les trois bluettes salonnardes commises par un gamin de 14 ans, ne s’imposait pas ! Le Nocturne, malicieusement sous-titré Hommage à John Field, alors qu’il en offre un détournement truffé de contrepoint polytonal et d’intrusions dodécaphoniques, sonne avec des timbres plus intéressants dans l’interprétation de 2010 qui en souligne les élégantes allusions à Chopin. Les Excursions, écrites pendant la guerre, constituaient le maillon faible du premier disque ; depuis, le sujet de Sa Gracieuse Majesté a pris la peine de décrypter les inimitables saveurs des genres populaires américains (boogie woogie, slow blues, ballade western, country music) autour desquels Barber a brodé d’ingénieuses variations. À l’inverse, la caractérisation des danses de salon réunies dans l’humoristique recueil Souvenirs op. 28 a perdu de la verve dont on se régalait en 1997 ; de plus, la définition compacte du nouvel enregistrement va jusqu’à rendre incompréhensibles les contre-harmonies (presque des mini-clusters) par lesquelles Barber torpille le thème bien typé de son Hesitation-Tango.
Alors, heureux possesseurs du disque Virgin, ne jetez pas votre exemplaire, il vous manquerait très vite, et complétez-le par le nouveau venu !
Sylviane Falcinelli